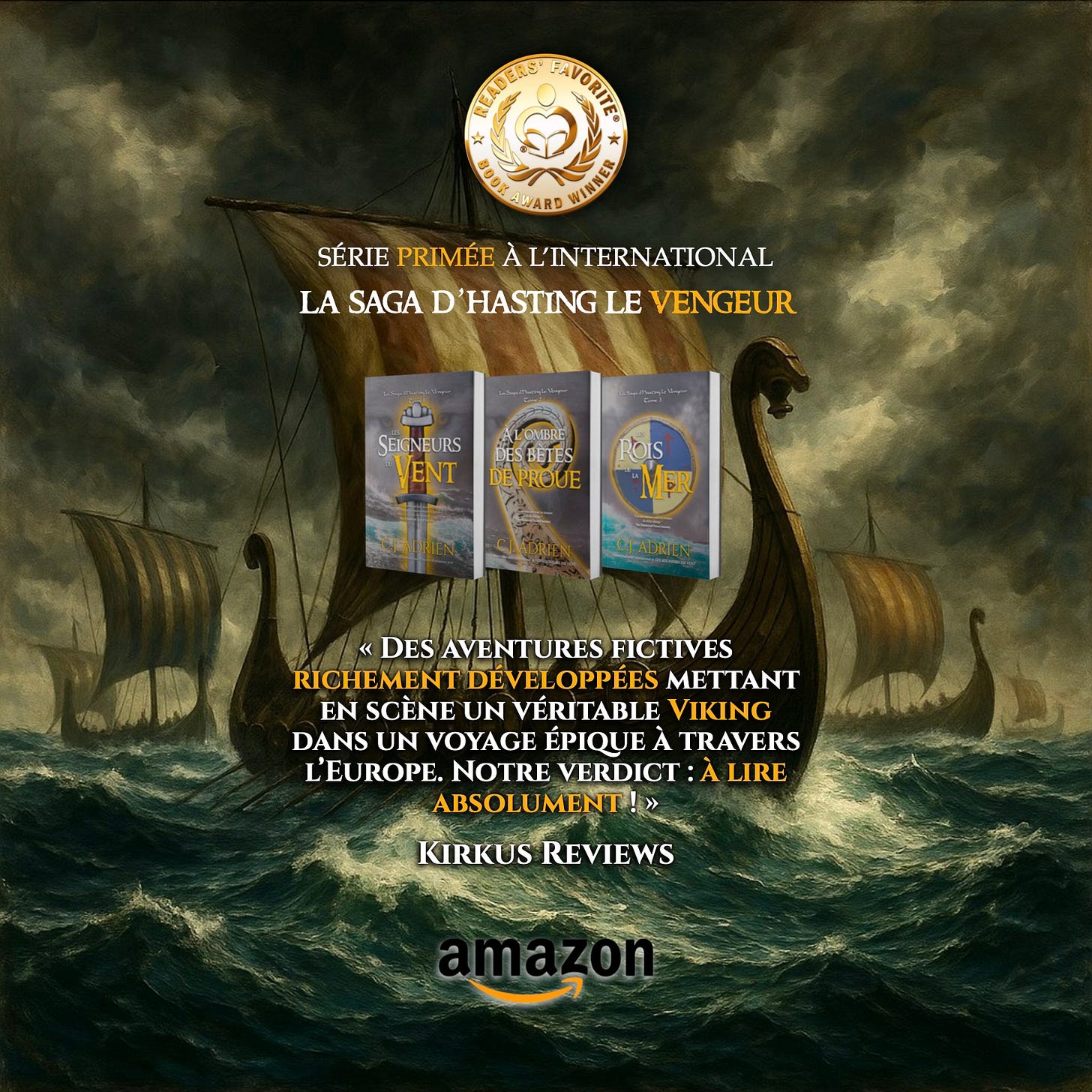Le Commencement Ambigu : le raid de 799 sur Noirmoutier
Une plongée au cœur des invasions vikings en France de l’Ouest — Épisode 1
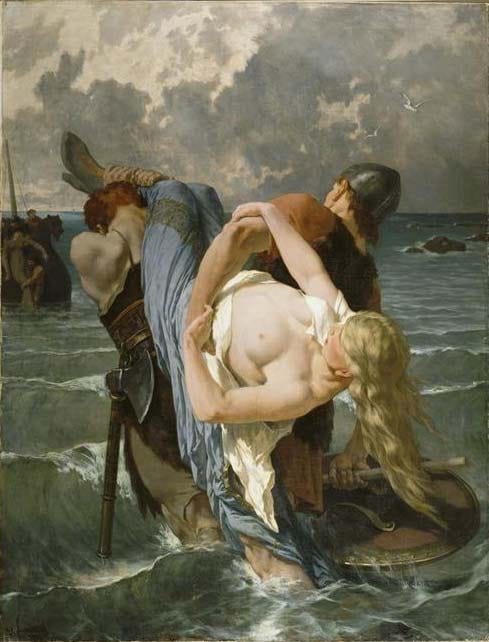
Le week-end dernier, au Salon du Livre de L’Épine, ici même sur l’île de Noirmoutier, j’ai rencontré des dizaines de lecteurs curieux, vendu un bon nombre de livres et eu des conversations inoubliables. Ce qui m’a le plus frappé, c’est combien peu de personnes, même sur l’île, connaissaient la place de Noirmoutier dans l’histoire viking. Pour la plupart, Lindisfarne en 793 est le fameux « premier » raid. Bien moins nombreux sont ceux qui ont entendu parler de l’attaque du monastère de Saint-Philibert en 799, que de nombreux historiens considèrent comme le début de deux siècles d’activité viking en France de l’Ouest.
Cela m’a donné une idée : et si je racontais cette histoire correctement, non pas en un seul long article, mais sous la forme d’une enquête approfondie et suivie ? Ainsi, pour le reste de l’année, je vais vous emmener semaine après semaine à travers chaque événement significatif des invasions vikings en France de l’Ouest : des raids aux batailles, des intrigues politiques aux débats entre historiens, en passant par mes propres réflexions sur ce que les sources laissent entrevoir.
Aujourd’hui, nous commençons tout au début — ou peut-être un début — avec une attaque qui, selon certains, n’aurait même pas été un raid viking.
Le récit traditionnel du raid de 799 sur Noirmoutier
La plupart des livres d’histoire modernes affirment qu’en 799, des Vikings attaquèrent le monastère de Saint-Philibert sur l’île de Noirmoutier. On le présente généralement comme un fait établi. La position de l’île à l’embouchure de la Loire en faisait une base avancée idéale pour les flottes scandinaves. Son monastère, comme celui de Lindisfarne six ans plus tôt, était riche, peu défendu et facilement accessible par mer.
Le cœur de cette tradition vient d’une lettre du théologien Alcuin d’York, célèbre pour avoir décrit les horreurs de Lindisfarne. Écrivant à l’évêque Arno de Salzbourg, Alcuin rapporte une attaque de paganae (« païens ») contre les îles d’Aquitaine. La formulation reste vague : aucun monastère n’est nommé, et « païens » pouvait désigner plusieurs groupes. Mais les historiens ont traditionnellement rattaché cette lettre aux récits carolingiens ultérieurs qui mentionnent une activité viking le long de la côte aquitaine.
Deux biographes impériaux du début du IXᵉ siècle renforcent cette interprétation. Rimbert, dans Les Deux Vies de Charlemagne, raconte qu’autour de l’an 800, l’empereur rencontra une flotte viking au large de l’Aquitaine ; lorsqu’ils apprirent que Charlemagne lui-même était présent, ils s’enfuirent. Einhard, dans sa Vita Karoli Magni, situe également Charlemagne en Aquitaine à cette époque et note que la région était « infestée par les Northmen » (Nordmannicis infestum erat).
Des sources ultérieures précisent encore le récit. Une lettre de l’abbé de Saint-Philibert en 819 se plaint de raids fréquents, ce qui suggère un phénomène remontant à plusieurs années. Dans les années 830, le moine Ermentaire évoque une première attaque, sans en donner beaucoup de détails. En combinant ces témoignages, l’historiographie traditionnelle s’impose : les Vikings auraient frappé Saint-Philibert en 799, ouvrant une longue période de raids sur l’île.
La remise en question du raid de 799 sur Noirmoutier
L’historien Simon Coupland a été l’un des premiers à contester publiquement ce récit. Ses principaux arguments sont les suivants :
Ermentaire mentionne aussi une tentative de raid maure dans la région, preuve que des flottes musulmanes d’al-Andalus étaient actives sur la côte ouest de la France à cette époque.
Alcuin employait parfois le terme paganae pour désigner les musulmans autant que les Vikings. Ainsi, quand il rapporte que des païens ont attaqué des « îles d’Aquitaine », il ne visait peut-être pas des Scandinaves.
Sans mention directe de « Northmen » ou de « Danois », attribuer l’attaque de 799 aux Vikings peut être anachronique, d’autant que les raids vikings indubitables dans la région apparaissent surtout 10 à 15 ans plus tard.
La mise en garde de Coupland est méthodologique : les historiens ne devraient pas assimiler chaque raid côtier du début du IXᵉ siècle à une attaque viking simplement parce que les sources ultérieures mettent en avant les Scandinaves.
Pourquoi je pense malgré tout qu’il s’agissait bien de Vikings
Il est vrai, comme le souligne Coupland, que les preuves pour 799 sont minces. Mais mince ne veut pas dire inexistante. Et à mes yeux, ce que nous avons vu correspond davantage à un raid viking qu’à une attaque maure. L’expression d’Alcuin « îles d’Aquitaine » s’accorde parfaitement avec Noirmoutier, l’Île d’Yeu et l’Île de Ré, comparables aux îles-relais déjà utilisées par les Scandinaves ailleurs, comme en Irlande ou dans les Hébrides. La chronologie aussi fait sens : après Lindisfarne (793) et Iona (795), progresser vers l’ouest et le sud en direction de la Loire, avec son accès à l’intérieur franc (et son sel !), aurait été une suite naturelle.
Les sources impériales renforcent cette idée. Rimbert et Einhard décrivent tous deux Charlemagne confronté à des « Northmen » en Aquitaine, difficile à concilier avec une simple attaque maure. Si seuls des musulmans avaient menacé la côte, pourquoi ces biographies indépendantes insisteraient-elles tant sur la menace scandinave ? Les intérêts d’Alcuin vont dans le même sens : il a beaucoup écrit sur les dangers que posaient les Norse à la chrétienté et aurait été prompt à relater un de leurs raids, bien plus qu’une incursion maure hors de sa sphère immédiate.
D’autres indices viennent de la réaction militaire immédiate de Charlemagne. Les Capitularia missorum specialiarapportent qu’il ordonna « de navigia praeparando circa littoralia maris » (« de préparer des navires sur les côtes maritimes »), « de navibus quas facere iussimus » (« sur les navires que nous avons ordonné de construire »), et « de materia ad naves faciendas » (« sur les matériaux nécessaires à la construction des navires »). L’Astronome note de même que Charlemagne « avait donné ordre alors de faire construire des navires contre les incursions des Northmen sur tous les fleuves se jetant dans la mer », et qu’il confia cette tâche à son fils sur la Garonne et la Loire. Ces mesures, datées par certains vers l’an 800, suivent de si près les événements de 799 qu’elles apparaissent presque comme une reconnaissance explicite de la menace viking. Elles auraient peu de sens si le raid avait été d’origine maure.
Enfin, la continuité joue un rôle. Dès 819, les moines de Saint-Philibert se plaignent d’attaques « fréquentes ». Ce schéma s’explique mieux si le phénomène avait commencé dès 799, plutôt que d’apparaître ex nihilo une décennie plus tard.
Aucun historien ne peut prétendre à une certitude absolue. Mais quand la géographie, la chronologie et les témoignages convergent dans la même direction, le poids des preuves penche, selon moi, vers une attaque viking plutôt que maure.
Pourquoi cet événement est important
À première vue, savoir si les assaillants de 799 étaient des Vikings ou des Maures peut sembler un détail. Mais dans une perspective plus large, cela modifie notre compréhension de la rapidité avec laquelle les Scandinaves passèrent des îles britanniques au monde franc, et de la vitesse à laquelle Charlemagne les identifia comme une menace stratégique.
Si 799 en marque le début, alors la pression viking sur l’empire commença du vivant de Charlemagne, et non après sa mort. Cela reconfigure l’interprétation de ses politiques côtières, de ses défenses fluviales et de son effort naval au début du IXᵉ siècle. Cela place aussi Noirmoutier directement au cœur du premier affrontement entre Carolingiens et Vikings, et non dans une vague secondaire.
Cela rejoint enfin mes recherches sur ce que j’appelle l’« Hypothèse du Sel » : l’idée que les premiers raids vikings en France de l’Ouest furent motivés en partie par le besoin de sel pour conserver le hareng destiné au commerce avec l’Est. Avec ses marais salants, Noirmoutier aurait représenté une cible de choix pour des Scandinaves cherchant à s’assurer cette ressource. Si le raid de 799 fut bien viking, alors il ne marque pas seulement le début de leur présence militaire, mais aussi le premier coup d’une campagne stratégique visant à contrôler l’une des denrées les plus précieuses du haut Moyen Âge.
La semaine prochaine : le raid de Bouin en 820
Si 799 fut le premier coup, ce ne fut pas le dernier. En 820, une flotte viking tenta de remonter la Seine, fut repoussée, et se tourna vers l’île de Bouin, moins bien défendue. Ils repartirent avec un « butin immense ». Cet épisode nous offre un regard encore plus clair sur les tactiques vikings des premières années de leurs raids en France de l’Ouest.
Nous explorerons ce récit la semaine prochaine : les sources, les implications stratégiques et comment des attaques comme celle de Bouin préparèrent le terrain à l’installation permanente des Scandinaves à Nantes plus tard dans le siècle.
Si cette série vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour recevoir chaque épisode directement dans votre boîte mail. À la fin de l’année, vous disposerez d’un guide chronologique complet des invasions vikings en France de l’Ouest, de Noirmoutier à la chute de Nantes, et au-delà.