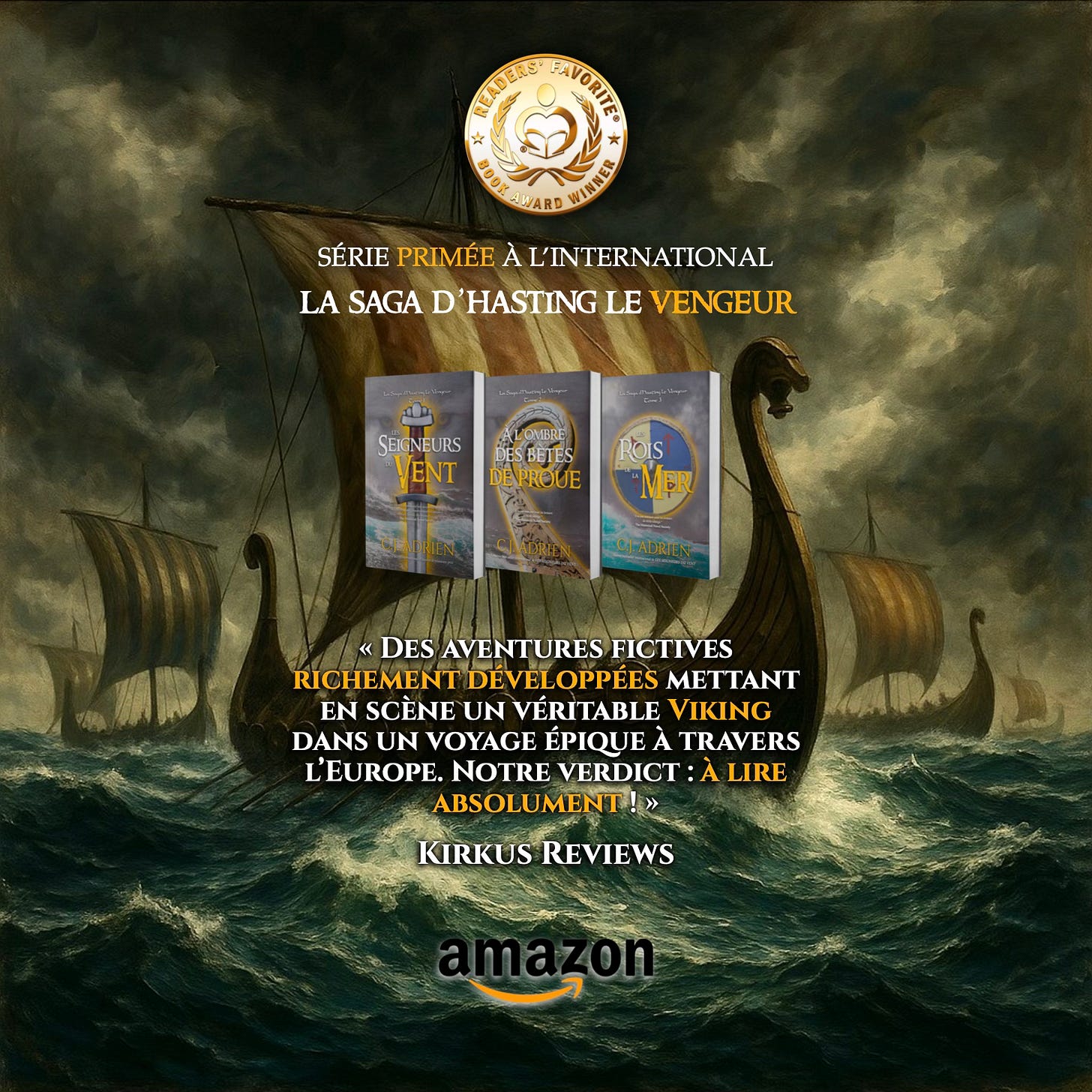Les Vikings à Bouin : le deuxième raid le plus ancien en France (prétendument)
Plongée dans les invasions vikings en France de l’Ouest — Épisode 2
La semaine dernière, j’ai écrit au sujet du prétendu raid viking contre Noirmoutier en 799, un événement débattu par les chercheurs mais central pour comprendre les débuts de la pression scandinave sur l’Empire carolingien. Cette semaine, tournons-nous vers un autre raid précoce : l’attaque contre Bouin. Les sources ne s’accordent pas sur la date exacte — certains parlent de 813, d’autres de 820 — mais dans tous les cas, l’événement éclaire la présence des Vikings en Aquitaine au début du IXe siècle. Avec d’autres indices épars, il suggère que les Scandinaves ont peut-être été plus actifs sur la côte atlantique sous Charlemagne et Louis le Pieux que ne le laissent entendre les maigres traces écrites conservées.
Une île disparue
Aujourd’hui, si vous partez de Nantes en direction de Noirmoutier, vous traverserez de vastes terres gagnées sur la mer, des champs plats ponctués de marais salants et d’oiseaux. Une route file droit vers l’île de Noirmoutier, célèbre pour ses plages, son sel et ses pommes de terre. Mais en chemin, vous passez par Bouin, une petite ville tranquille qui semble enclavée. Difficile d’imaginer qu’au début du IXe siècle, Bouin était entourée par la mer, et qu’elle fut l’une des premières communautés de France à ressentir le choc des raids vikings.
Au IXe siècle, Bouin se trouvait dans la baie de Bourgneuf, une île basse face à Noirmoutier. Toutes deux faisaient partie d’un paysage maritime dominé par les chenaux, les marais et la production de sel. Pour des raiders scandinaves sondant les côtes franques, Bouin et Noirmoutier étaient des cibles tentantes : riches, accessibles par bateau, et faiblement défendues.
Depuis, la géographie a changé. À partir du XVIIe siècle, des ingénieurs hollandais asséchèrent les marais du Marais breton-vendéen, érigeant digues et polders qui rattachèrent les îles au continent. Aujourd’hui, Bouin n’est plus une île, mais une bourgade sur la route de Noirmoutier. À l’époque viking, pourtant, elle était ceinturée par les eaux, ses marais salants et ses réserves de poisson et de bétail représentant une proie idéale pour des hommes en drakkar.
813 ou 820 ?
Alors, quand les Vikings frappèrent-ils Bouin ? Ici, les sources divergent. Certains récits secondaires donnent 813, mais la preuve la plus sûre concerne 820.
Les Annales royales franques (Annales Einhardi), rédigées peu après les faits, rapportent qu’en 820 une flotte viking, après des raids infructueux en Flandre et à l’embouchure de la Seine, descendit vers l’Aquitaine. Là, ils « dévastèrent complètement un vicus appelé Bundium [Bouin] et rentrèrent chez eux avec un immense butin. »
Mais même si l’attaque que nous pouvons dater avec certitude eut lieu en 820, les indices suggèrent que Bouin et ses voisins furent harcelés bien avant.
« À cause des incursions fréquentes »
Un an plus tôt, en 819, l’empereur Louis le Pieux émit un diplôme royal pour l’abbé Arnulf de Noirmoutier. Celui-ci autorisait la fondation d’un monastère satellite à Déas (aujourd’hui Saint-Philibert-de-Grand-Lieu), plus à l’intérieur des terres. La raison est explicite : il était nécessaire « à cause des incursions des barbares qui ravagent fréquemment le monastère de Noirmoutier. »
Ce n’est pas une plainte de moine rédigée des années plus tard, mais bien un document administratif ferme (ah, l’administration française !). Avant même la mention de 820 dans les annales, les moines de Saint-Philibert subissaient déjà une pression constante et durent déplacer leur communauté à l’intérieur des terres pour survivre. Le raid de Bouin en 820 ne fut donc pas un incident isolé, mais une étape d’un harcèlement répété dans l’estuaire ligérien.
Charlemagne et les hommes du Nord
Les signes de cette pression remontent encore plus loin. Éginhard, le biographe de Charlemagne, rapporte dans sa Vie de Charlemagne que l’empereur avait organisé des défenses côtières contre les hommes du Nord, comme il l’avait fait contre les raids musulmans au sud. Même si Éginhard reste avare de détails, il montre que la menace maritime était déjà reconnue du temps de Charlemagne.
L’anecdote la plus célèbre vient toutefois de Notker le Bègue, écrivant plus tard au IXe siècle. Il raconte que Charlemagne, dans une villa du littoral de la Gaule narbonnaise, reçut la nouvelle de la présence de navires nordiques au large. L’empereur se leva de table, regarda par la fenêtre, et vit les bateaux fuir « avec une rapidité merveilleuse ». Les Francs ne purent les rattraper — leurs navires étaient trop rapides. Charlemagne pleura, disant qu’il avait « le cœur malade », non par crainte pour lui-même, mais parce qu’il prévoyait les destructions que ces ennemis feraient subir à ses descendants.
Le récit de Notker, considéré comme apocryphe par la plupart des historiens, est teinté de rétrospective et de leçon morale. Mais cette scène saisit une vérité : la mémoire de navires vikings sur la côte aquitaine existait déjà du temps de Charlemagne, et même le grand empereur ne pouvait les arrêter.
Pourquoi Bouin ? L’hypothèse du sel
Pourquoi les Vikings s’acharnèrent-ils sur ces îles en particulier ? La réponse se trouve sans doute dans la géographie et le commerce.
Noirmoutier et Bouin étaient des îles productrices de sel. Or, le sel était l’agent de conservation indispensable du monde médiéval, et il aurait pris une importance croissante au début du IXe siècle avec l’essor de la pêche au hareng dans la Baltique. Selon ma théorie, les marchands scandinaves avaient besoin de grandes quantités de sel pour conserver le poisson destiné à l’exportation vers les marchés de l’Est. Si l’on prend au sérieux le diplôme de 819, qui parle d’« incursions fréquentes et persistantes », alors il suggère que les Vikings visaient une ressource essentielle pour eux.
C’est le cœur de ce que j’ai appelé l’hypothèse du sel : l’acharnement des Vikings sur des lieux comme Noirmoutier et Bouin s’expliquerait en partie par le besoin d’un approvisionnement sûr en sel pour le commerce.
Dans cette perspective, le raid de Bouin en 820 témoigne d’une demande structurelle qui a alimenté l’activité viking plusieurs décennies avant les grandes campagnes fluviales des années 840.
Ce que l’on sait… et ce que l’on ignore
Comme souvent avec l’histoire des débuts de l’ère viking, le tableau reste frustrant d’incomplétude. Les annales nous donnent quelques points fixes, mais elles sont laconiques et parfois contradictoires. Les chartes monastiques et les anecdotes comblent certaines lacunes mais sont marquées par leurs agendas. Nous pouvons affirmer avec certitude que Bouin fut attaqué en 820, que Noirmoutier subit des raids répétés auparavant, et que Charlemagne mit en place des défenses en réaction à ces menaces vers la fin de son règne (des mesures que j’ai abordées dans l’épisode précédent).
Ce que nous ne pouvons pas dire, c’est combien d’autres raids sont passés sous silence, ou comment les communautés locales vécurent la pression au fil des années. Pour chaque mention conservée, il a pu y avoir plusieurs étés de tension qui n’ont laissé aucune trace écrite.
Conclusion
L’attaque de Bouin peut sembler une note de bas de page comparée au spectaculaire sac de Nantes en 843. Pourtant, elle mérite l’attention car elle ancre la toute première phase de l’activité viking sur le littoral atlantique franc. C’est la deuxième étape d’une progression implacable des raids en France de l’Ouest qui allait durer plus d’un siècle.
La semaine prochaine, nous plongerons dans les années 820, une décennie qui révèle à quel point les moines de Noirmoutier étaient sous pression. Les chartes royales de cette période laissent entrevoir l’importance économique de leur sel et les mesures extraordinaires qu’ils prirent pour se protéger des incursions vikings.